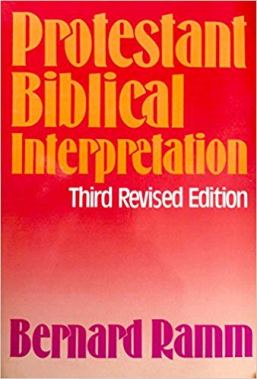 Ces notes sont tirées très librement de Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, Grand Rapids: Baker Book House, 1970, 3e édition révisée.
Ces notes sont tirées très librement de Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, Grand Rapids: Baker Book House, 1970, 3e édition révisée.
L’HERMENEUTIQUE DANS LE PASSE ET DANS LE PRESENT
L’école allégorique (Ramm, pp. 23‑45)
Introduction. L’interprétation allégorique croit qu’en‑dessous la lettre, le message clair d’une écriture, on peut discerner la vraie signification du passage. Exemple: Juges 9:7‑20. La reproche de Nathan à David (2 Samuel 12:1‑10). Dans ces cas, les allégories sont intentionnellement construites par les auteurs pour communiquer un message qui au début est caché. Il faut avouer que l’interprétation allégorique n’est pas toujours sans base. Mais si nous présumons que toute écriture a une signification cachée, même s’il n’y en a pas la moindre suggestion dans le texte, nous bâtirons notre interprétation sur le sable.
L’allégorie grecque
Les Grecs avaient deux traditions: (1) l’héritage religieux de Homer (et de Hésiode), et (2) la tradition philosophique et historique. La tradition religieuse avaient des éléments qui étaient fantastiques, grotesques, absurdes, et immoraux. Ces éléments n’étaient pas acceptables devant les philosophes, mais on ne pouvait rejeter Homer, étant donné la popularité de ses écrits. Que faire? Allégoriser ses écrits. Les histoires des dieux, et les écrits des autres poètes n’étaient pas à se comprendre littéralement. Plutôt, il fallait discerner la vraie et secrète signification.
Il importe de noter que cette méthode d’interprétation a atteint la ville d’Alexandrie où se trouvait une grande population juive, et éventuellement une grande population chrétienne.
L’allégorie juive
Le Juif d’Alexandrie était confronté par un problème pareil à celui de son voisin grec. En tant que fils de Moïse, il était instruit dans la loi et la révélation divine. Pourtant, il était confronté par la littérature grecque avec son héritage philosophique, et il en était impressionné. La méthode allégorique employée par les Grecs était déjà disponible, et le Juif en a profité pour trouver la philosophie grecque dans les Saintes Ecritures. Par extension, les chrétiens ont adopté cette nouvelle méthode d’interprétation qui étaient auparavant inouïe, laquelle est restée inébranlable pendant plus de quinze siècles.
Aristobule (160 av. J.-C.) a été peut‑être le premier Juif d’employer cette méthode, et il a été suivi par Philon (20 av. J.‑C. ‑ 54 ap. J.‑C.) qui l’a bien appliquée et développée. Aristobule a affirmé que la philosophie grecque avaient beaucoup emprunté de l’Ancien Testament, et qu’en employant la méthode allégorique on pourrait trouver la philosophie grecque dans les Ecritures juives.
Philon a cru que les Ecritures juives étaient bien supérieures au platonisme et à la philosophie grecque. Il a accepté la théorie de l’inspiration par dictée, pourtant, il a aimé la philosophie grecque, surtout Platon et Pythagore. Par son système il a pu concilier pour lui‑même sa loyauté aux Ecritures avec son amour pour la philosophie grecque. Philon n’a pas pensé que la signification littérale soit inutile; elle représentait pour lui un niveau de compréhension qui manquait de maturité. Le sens littéral était le corps des Ecritures, le sens allégorique son âme.
Le système allégorique
Les Grecs───────> Les Juifs d’Alexandrie ───────> Les chrétiens
La conviction de base de l’église primitive était que l’Ancien Testament était un document chrétien. Cette conviction pourvoyait l’approbation nécessaire d’employer cette méthode d’interprétation qui était grecque !
Des difficultés en résultaient pour les Pères de l’église : (1) le sens historique a été perdu, (2) ils n’ont pas vu clairement le progrès de la révélation, (3) ils ont cru que l’Ancien (surtout) et le Nouveau Testament étaient plein de paraboles et énigmes, (4) ils ont confondu l’allégorique avec le typique, (5) ils ont cru que la philosophie grecque était dans l’Ancien Testament, et qu’elle était découverte par la méthode allégorique, (6) puisque la méthode est arbitraire, elle a encouragé le dogmatisme.
La malédiction de la méthode allégorique est qu’elle obscurcit la vraie signification de la Parole de Dieu, et si elle n’avait pas gardé au centre la vérité de l’évangile, elle serait devenu hérétique. En fait, c’est exactement ce qui s’est passé quand les gnostiques ont allégorisé le Nouveau Testament. La Bible traitée d’une manière allégorique devient du mastic dans la main de l’exégète. Des systèmes différents pouvaient surgir dans le cadre de l’herméneutique allégorique sans moyen pour déterminer lesquels étaient corrects. C’est précisément un des problèmes pour la réfutation du gnosticisme. Les orthodoxes voulaient allégoriser l’Ancien Testament, mais pas le Nouveau Testament. Les gnostiques les ont accusés d’être inconsistants. La seule méthode pour s’échapper à ce match nul est de retourner à l’interprétation saine, propre, et littérale des Ecritures. La méthode allégorique met la prime sur le subjectifs, et le triste résultat est l’obscurcissement de la Parole de Dieu.
Clément a trouvé cinq significations possibles : (1) historique, (2) doctrinale, (3) prophétique, (4) philosophique, et (5) mystique.
Origène était motivé de démontrer que Nouveau Testament avaient ses racines dans l’Ancien Testament. Il voulait que les Ecritures soient acceptables devant les gens philosophiques. Ses principes sont les suivants : (1) La signification littérale est le niveau de base (2) Pour comprendre la Bible, nous devons recevoir de la grâce de la part de Christ (3) La vraie exégèse est celle qui est spirituelle. La Bible est une vaste allégorie (4) L’Ancien Testament est la préparation pour le Nouveau Testament qui est caché dans l’Ancien.
Jérôme a traduit la Bible en latin. Il a noté que l’Apocryphe ne se trouvait pas dans la Bible hébraïque et à cause, alors, de sa nature secondaire, il fallait le mettre entre les Testaments, ce qui n’a pas été effectué avant Luther. Au début, Jérôme pratiquait la méthode allégorique, mais plus tard il a été influencé par l’école littérale d’Antioche. Pourtant, il le trouvait difficile de laisser tomber ses habitudes allégoriques.
Augustin a étalé les principes suivants : (1) La foi est nécessaire pour comprendre les Ecritures (2) L’interprétation littérale et historique est importante bien qu’elle ne soit pas le but des Ecritures (3) Les Ecritures ont plus d’une signification, ce qui justifie la méthode allégorique (4) Les chiffres bibliques ont des significations (5) L’Ancien Testament est un document chrétien et christologique (6) La tâche de l’interprète n’est pas d’imposer une signification, mais de la faire sortir du texte (7) L’amour et la comparaison avec le credo sont essentiels (8) On ne doit pas isoler un verset de son contexte (9) Si l’interprétation n’est pas certaine, elle ne peut servir comme base de la foi (10) Nous ne pouvons pas substituer le Saint-Esprit pour la connaissance essentielle (11) Le passage obscur doit céder au passage clair (12) Les Ecritures ne peuvent se contredire. Malheureusement, Augustin violait fréquemment tous ses principes !
L’allégorie catholique
Pendant le moyen âge, la prépondérance de l’oeuvre exégétique était allégorique. Mais l’approche catholique a été influencée par les études protestantes de sorte que les savants catholiques avouent que l’interprétation de certains interprètes catholiques était extrême, et l’importance de la signification littérale est vantée. Ramm décrit l’approche des catholiques : (1) Les savants catholiques acceptent la Vulgate comme la version authentique pour les discours, les disputes, et les sermons (2) L’interprète accepte tout ce que l’Eglise Catholique a spécifié quant aux questions de l’introduction biblique (3) Il accepte toute interprétation officielle (4) L’interprétation littérale et historique des Ecritures est le fondement de l’étude de la Bible (5) Les Ecritures possèdent une signification spirituelle ou mystique que surpasse le sens littéral, mais cette signification spirituelle doit être construite sur la signification littérale (6) L’Eglise Catholique est le gardien de la Tradition et des Ecritures, donc, elle est l’interprète officiel des Ecritures (7) Les Pères peuvent nous guider lorsqu’ils (a) traitent avec des questions de la foi et de la moralité (et non des questions scientifiques ou historiques), (b) rendent témoignage à la Tradition Catholique, et (c) sont unanimes dans leur interprétation (8) L’enseignement obscur d’un passage doit être expliqué par la tradition plus complète de l’Eglise (9) La Bible est à être comprise selon le principe du développement. Les doctrines du Nouveau Testament sont des graines qui développent. Il n’est pas donc nécessaire que l’Eglise Catholique soit identique en forme à l’église primitive ; elle est le développement des graines qui se trouvaient dans le Nouveau Testament (10) L’Eglise Catholique considère les études faites par les protestants d’être d’une qualité inférieure. Les protestants rongent l’écorce du cocotier sans manger le noix du coco.
L’INTERPRÉTATION LITTÉRALE (Ramm, pp. 45-60)
Introduction. Selon la méthode de l’interprétation littérale, on devrait être satisfait de la signification littérale d’un texte à moins que des raisons très substantielles ne soient présentées par le texte pour outrepasser le sens littéral. La Bible est interprétée selon les règles ordinairement appliquées à la langue. Elle contient des déclarations basées sur les faits, des locutions, des métaphores, des idées poétiques, des fables, et des allégories. Cette approche cherche à interpréter chaque expression selon sa nature et sa fonction.
L’interprétation littérale juive
Esdras est considéré le fondateur de l’école extrêmement littérale (Néhémie 8:1-8). La littéralité extrême considère comme saintes les lettres mêmes de la Parole de Dieu. A cause de cela, les scribes ont copié les Ecritures très soigneusement. Les Juifs de la Palestine ont développé quelques principes herméneutiques : (1) Un mot doit être compris dans le contexte de la phrase, et la phrase doit se comprendre dans le contexte plus large (2) Les Ecritures qui traitent avec un certain sujet doivent être comparées (3) Ce qui est clair est préféré à ce qui est obscur (4) On examine attentivement l’orthographe, la grammaire, et les locutions (5) On emploie la logique pour appliquer les Ecritures au sujets qui ne sont pas traités dans les Ecritures (6) Puisque le Dieu d’Israël a parlé dans les langues humaines, Il a adapté sa révélation à ses récipients.
Les littéralistes ont commencé à trouver des significations non seulement dans les phrases et dans les mots, mais aussi dans les lettres (notarikon) et les chiffres (gemetria). Par cette exaltation des lettres des Ecritures, la vraie signification des Ecritures a été perdue.
L’école d’Antioche
Les chrétiens à Antioche ont évité la littéralité des Juifs et l’allégorie d’Alexandrie. Ils ont insisté sur le sens historique et grammatical, et ils ont reconnu le progrès de la révélation. Par exemple, l’enseignement à propos de Jésus-Christ est plus riche dans l’Evangile selon Luc que dans la Genèse. Cette école est devenue le pilier de la Réformation, et la méthode exégétique principale de l’Eglise. Exemples de cette école : Lucien, Diodore, et Chrysostome.
Les Victorines
Pendant la période médiévale l’abbaye de St Victor à Paris a hébergé une école bien influencée par les savants juifs. Cette école employait la méthode historique et littérale.
Les réformateurs
Les principes herméneutiques de Luther étaient les suivants : (1) Le principe psychologique. La foi et l’illumination sont nécessaires pour l’interprète (2) Le principe de l’autorité. La Bible est l’autorité suprême et finale (contre l’autorité ecclésiastique) (3) Le principe littéral. Luther rejetait l’allégorie comme employée par les catholiques. En principe il l’avait répudiée, mais en pratique, il n’en était pas entièrement libre. Il acceptait la primauté des langues d’origine (4) Le principe de la compétence. Le chrétien dévoué et compétent peut comprendre le vrai sens des Ecritures. L’Ecriture interprète l’Ecriture (5) Le principe christologique. La fonction de toute interprétation est de trouver Christ (6) Le principe de la distinction entre la Loi et l’évangile.
Calvin (1) a insisté sur l’illumination par l’Esprit (2) Il a rejeté l’interprétation allégorique (3) Il interprétait les Ecritures par les Ecritures (4) Il se démontrait indépendant de l’exégèse superficielle.
Post-Réforme
Selon cette école de pensée, la valeur principale de la Bible est son emploi pour l’édification pour le croyant individuel. Cet accent pratique est absolument nécessaire. Pourtant, avec cette cible en vue, on peut tomber dans l’allégorisation surtout de l’Ancien Testament. Il ne faut pas substituer cette approche pour les études exégétique et doctrinales.
L’INTERPRÉTATION LIBÉRALE
Voici les principes de l’interprétation libérale : (1) La mentalité moderne doit gouverner notre approche aux Ecritures. La science présume la régularité de la nature, donc, les miracles sont rejetés. Les doctrines du péché, la dépravation, et l’enfer sont offensives et rejetées (2) L’inspiration est redéfinie. C’est le pouvoir d’inspirer l’expérience religieuse actuelle, ce qui est le coeur de la religion. Le contenu doctrinal ou théologique des Ecritures n’est pas obligatoire (3) Le surnaturel est redéfini pour signifier la prière, l’éthique, la pensée pure, et l’immortalité, mais les descriptions des miracles sont des folklores ou la mythologie (4) Le concept de l’évolution est appliqué à la Bible. La loi devient le développement des prophéties, et le Nouveau Testament, même les évangiles, reflète les besoins spirituels de l’église primitive (5) La notion de l’accommodation est appliquée à la Bible. Les déclarations théologiques sont transitoires. Jésus a accommodé son enseignement aux idées des Juifs, surtout à propos des questions de l’Introduction Biblique, par exemple, l’historicité d’Adam et d’Eve, de Jonas, etc (6) La Bible est le produit de l’histoire et des conditions sociales. Son contenu a été emprunté des religions voisines (7) La philosophie porte une grande influence. Pour Immanuel Kant, rien que l’interprétation morale importe. Le déisme aussi mettait l’accent sur l’éthique. L’hégélianisme à été appliqué à l’Ancien Testament par Wellhausen, et au Nouveau Testament par F. C. Baur.
LA NÉO-ORTHODOXIE
Karl Barth a inauguré une nouvelle ère dans l’interprétation biblique à la fin de la première guerre mondiale quand il a publié son Römerbrief, son interprétation de l’épître aux Romains. Voici les principes de l’herméneutique néo-orthodoxe : (1) Le principe de la révélation. L’infaillibilité et l’inspiration orthodoxe sont niées. La Bible est contredite par la science, l’anthropologie, l’histoire, et la géologie. La révélation existe quand Dieu parle. Mais son langage est sa présence. Quand je réponds à ce qu’il me dit par Jésus-Christ, c’est la révélation. La Bible n’est pas une parole de Dieu directe, mais le rapport et le témoignage de la révélation. La Bible contient le témoignage de la révélation dans le passé, et la promesse de la révélation dans l’avenir. La Bible est un témoin à la révélation qui est digne de confiance, mais faillible. L’interprète néo-orthodoxe cherche à découvrir un témoin original à la Parole de Dieu dans les mots faillibles et humains de la Bible (2) Le principe christologique. Les doctrines qui n’indiquent pas le Christ ne sont pas obligatoires. Par exemple, les doctrines de la création et du péché (3) Le principe de la totalité. On ne peut baser une doctrine sur quelques textes scripturaires; il faut la baser sur la totalité des Ecritures (4) Le principe mythologique. La création de l’univers, la création de l’homme, l’innocence de l’homme, la chute de l’homme, et la seconde venue de Christ sont des mythes bibliques avec beaucoup de signification. La seconde venue de Christ veut dire que l’homme ne pourra jamais trouver le bonheur ni sa valeur dans son existence purement historique (5) Le principe existentiel. La Bible contient de l’histoire et de la théologie. Pourtant, son accent est sur l’existence, la vie, et Dieu. Pour comprendre la Bible, on doit s’engager avec le texte (6) Le principe paradoxale. L’homme, étant limité et pécheur, ne peut jamais avoir une connaissance claire de Dieu. La vérité de Dieu lui semble paradoxale. Quelques exemples : L’homme doit perdre la vie pour la sauver ; la croix est la folie et la sagesse de Dieu.
L’ÉCOLE HISTOIRE DU SALUT (HEILSGESCHICHTLICHE)
Cette approche considère la Bible comme une histoire du salut. Elle trace dans l’histoire et dans la doctrine le développement de l’intention divine dans le salut des hommes. La précision du texte dans le domaine de l’histoire, l’astronomie, la géologie, etc., n’est pas importante. On cherche à comprendre le cadre historique, le point de vue de l’auteur et des récipients, et puis il faut répondre au défi de la Bible.
L’HERMÉNEUTIQUE NOUVELLE DE BULTMANN
Les essentiels de l’herméneutique de Bultmann sont les suivants : (1) Le principe scientifique. Toute question doit être décidée par la science (2) Le principe critique. Le cadre historique est plus important que l’exégèse du texte. On emploie la méthode de l’école “l’histoire des religions” pour découvrir l’arrière-plan religieux du document. On emploie la critique des formes pour discerner l’origine des déclarations, des histoires des miracles, et des mythes. On doit différencier ce qui est dit de sa signification (3) Le principe mythologique. Les expressions de foi, de doctrine, ou de miracles, sont des mythes (4) Le principe de démythification. Le savant doit dénuder le mythe pour recouvrer sa signification originelle (5) Le principe dialectique. Si un événement est historique, il n’est pas un objet de la foi. Et les objets de la foi ne sont pas historiques. Pourtant, la croix est tous les deux. L’historien ne peut déduire la signification de la croix. Cette signification ne se connaît que par la foi (6) Le principe révélateur. La révélation ne consiste pas de vérités, de concepts, ou de doctrines. Elle se compose d’un rencontre existentiel avec Dieu (7) Le principe de la loi. L’Ancien Testament n’a pas présagé les doctrines du Nouveau Testament.
Bultmann s’accorde avec le libéralisme en ce qu’il croit que l’intellect de l’homme est capable de juger la crédibilité du contenu biblique. Il s’accorde avec la néo-orthodoxie dans l’idée que la révélation est une expérience subjective et non objective.
La nouvelle herméneutique est bâtie sur l’approche de Bultmann. Voici ses principes : (1) Le principe critique. L’interprète du Nouveau Testament doit reconnaître où la foi des auteurs du Nouveau Testament ont élaboré, soit inventé. Les disciples de Bultmann ont lancé la nouvelle quête pour le Jésus de l’histoire (2) Le principe herméneutique. L’herméneutique n’étale plus les règles pour interpréter les Ecritures ; elle traite avec la compréhension et l’expérience de l’auteur et ses méthodes de s’exprimer (3) Le principe de langage. On emploie un langage existentiel pour parler de l’expérience subjective du lecteur des Ecritures.
CHAPITRE III
PERSPECTIVES THEOLOGIQUES (Ramm, pages 93-113)
Il est possible d’être si entraîné par les principes de l’interprétation que l’on oublie que le but d’étudier la Bible est de produire de la transformation dans notre vie et dans la vie des autres. De l’autre part, on peut s’absorber dans la transformation au degré de penser que de suivre les principes de l’interprétation n’est ni nécessaire ni spirituel. Nous voulons éviter ces deux positions extrêmes.
L’INSPIRATION, LE FONDEMENT
L’interprète chrétien partage beaucoup avec le partisan des études classiques. Pourtant, le chrétien reconnaît qu’il traite avec des documents inspirés de l’Esprit Saint. Cette dimension ajoute les traits suivants : (1) A cause de l’aspect moral ou spirituel de la Bible, l’interprète doit avoir des qualifications spirituelles (2) La Bible a un aspect surnaturel. Le protestant prend au sérieux les miracles enregistrés dans la Bible (3) Bien que la Bible emploie des termes qui existaient déjà dans le grec et dans l’hébreu, cet emploi approfondit la signification des termes tels que la foi, l’amour, la miséricorde, la rédemption, le salut, le ciel, et le jugement.
L’interprétation protestante est caractérisée par certaines attitudes : (1) On s’approche de la Bible avec la foi, la confiance, la prière, et la piété (2) On s’engage dans la critique biblique (3) On essaie de découvrir le texte originel, d’appliquer les règles de l’interprétation, et d’éviter l’eisogèse.
L’ÉDIFICATION : LE BUT
La Bible n’est pas la fin ; elle est le moyen. Le but de la vérité historique, doctrinale, et pratique de la Bible est de promouvoir la prospérité spirituelle de l’homme. L’interprétation théologique n’est pas suffisante. La Bible est plus qu’un livre théologique. Elle est un livre religieux ; et la religion est plus que la théologie. L’étude de la Bible doit développer des compréhensions justes concernant Dieu, l’homme, et le service ; elle devrait nourrir des relations justes avec Dieu.
LA MÉTHODE PROTESTANTE D’HERMÉNEUTIQUE
Perspectives theologiques
La clarté des Ecritures
L’Eglise Catholique croit que les Ecritures sont obscures. Elle croit aussi qu’elle est la voix officielle de l’Esprit, et qu’il est sa responsabilité d’interpréter les Ecritures. Les réformateurs ont rejeté ce point de vue. Luther a distingué la clarté externe et la clarté interne des Ecritures. La clarté externe est sa clarté grammaticale. L’interprète suit les règles de la langue pour connaître la signification des Ecritures. La clarté interne des Ecritures est l’oeuvre du Saint Esprit dans le coeur et dans l’intelligence du croyant, pour qu’il voie la vérité des Ecritures comme la vérité de Dieu.
L’accommodation de la révélation
Dieu s’est accommodé à l’esprit humain pour que nous comprenions sa vérité. Les Ecritures sont écrites dans les langues humaines (hébreu, araméen, et grec). La révélation a un caractère anthropomorphique. Le caractère accommodé se voit surtout dans le Tabernacle et les paraboles de Jésus. On parle du bras de Dieu pour indiquer sa puissance. Etre assis à la droite de Dieu indique la prééminence. L’interprète qui est au courant de ce caractère anthropomorphique de la révélation divine ne sera pas coupable des formes grotesques d’une exégèse littérale. Plus d’une personne illettré a compris les anthropomorphismes des Ecritures d’une manière littérale et en a conclu que Dieu possède un corps.
La progression de la révélation
En parlant de la progression de la révélation, nous ne voulons pas dire que la révélation biblique soit le résultat de l’évolution. La “révélation progressive” indique l’initiative de Dieu, et non de l’homme, par laquelle Dieu mène l’homme à travers l’enfance théologique de l’Ancien Testament à la maturité du Nouveau Testament. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas d’idées mûres dans l’Ancien Testament ni des éléments simples dans le Nouveau Testament. Plutôt, la révélation progressive est le plan général de la révélation. Voir Matthieu 5:17-20 ; Galates 3:23-4:7 ; et Hébreux 1:1-2.
Cette révélation progressive n’indique pas que l’Ancien Testament soit moins inspiré que le Nouveau. Elle indique plutôt que la plénitude de la révélation se trouve dans le Nouveau Testament.
Les Écritures sont interprétées par les Écritures
Les réformateurs croyaient que les Saintes Ecritures dans leur entièreté pourvoyaient le contexte et le guide pour la compréhension des passages particuliers. Donc, le théologien doit baser sa doctrine sur les passages dont la signification est claire et non sur ceux qui sont obscurs, par exemple la sorcière à Endor, ou le baptême pour les morts (1 Corinthiens 15:29).
L’unité formelle et systématique
Ce principe correspond au précédent. L’analogie de la foi est l’harmonie constante et perpétuelle des Ecritures sur les points fondamentaux de la foi et de la pratique. Les interprétations des passages spécifiques ne doivent pas contredire l’enseignement total des Ecritures sur un point. Louis Berkhof étale les règles suivantes : (1) Un passage obscur ne peut contredire ce qui est clairement enseigné ailleurs dans la Bible. Par exemple, 1 Jean 3:6 ne peut annuler les autres textes qui enseignent que les croyants pèchent (2) Un passage qui est clair dans son enseignement mais qui n’est pas soutenu d’une manière directe par le reste des Ecritures peut pourvoir la fondation d’une doctrine. Pourtant, une telle doctrine n’est pas aussi forte que celle qui est soutenue et affirmée par une base scripturaire plus large (3) Les doctrines basées sur les passages obscurs et qui n’ont pas le soutien du reste des Ecritures devraient être acceptées avec beaucoup de réserve, si l’on les accepte (4) Si les Ecritures semblent soutenir deux vérités opposées (telles que la dépravation totale et la responsabilité humaine), les deux doctrines devraient être tenues dans la confiance qu’une unité supérieure existe.
L’unité de la signification de l’Ecriture
Nous employons ce terme “unité” en contraste avec le terme “pluralité” ou “diversité”. Nous ne voulons ni réduire les Ecritures à une littéralité étroite, ni n’ignorer ses aspects prophétiques ou typologiques, mais nous voulons nous opposer aux méthodes outrageuses employées dans les cultes, le piétisme protestant, et l’interprétation allégorique. A la base de ces approches se trouve la notion que chaque verset a des significations multiples où l’intention de l’auteur n’est pas prise au sérieux.
L’interprétation et l’application
Nous avons déjà vu que le but de l’herméneutique est l’édification. Pourtant, nous devons bien distinguer l’interprétation (la signification) d’un passage de son application. Il n’y a qu’une interprétation juste, mais il y a plusieurs applications. Dans son désir de rendre la Bible pertinente à la vie quotidienne, le prédicateur est parfois tenté de négliger la signification de son passage. Son assemblée est alors laissée avec la fausse impression que son message, c’est-à-dire son application, exprime la signification originale du texte.
[1] Ces notes sont tirées très librement de Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, Grand Rapids: Baker Book House, 1970, 3e édition révisée. ─ J. Gary Ellison, traducteur. Un grand merci à la mère d’un ancien étudiant pour des corrections.




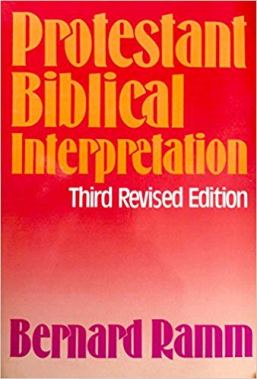 Ces notes sont tirées très librement de Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, Grand Rapids: Baker Book House, 1970, 3e édition révisée.
Ces notes sont tirées très librement de Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics, Grand Rapids: Baker Book House, 1970, 3e édition révisée.

